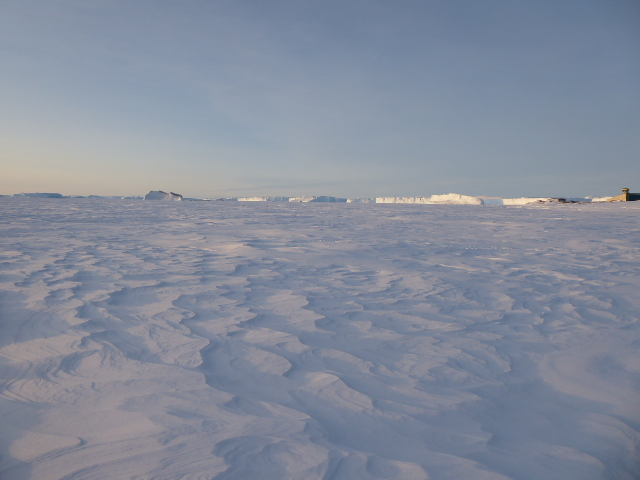Les manchots Adélie sont de retour à Dumont d'Urville, signe annonciateur de la période estivale. Le premier sur l'ile des pétrels a été aperçu le 29 septembre. Sur le moment, il paraissait bien seul mais dans quelques semaines, ils seront environ 30.000 sur l'ile et 80.000 dans l’ensemble de l'archipel de pointe géologie. Autant vous dire que si l'humain avait pris possession de l'ile depuis plusieurs mois, il ne sera plus chez lui très bientôt.....😕.
-K300.jpg) |
| Céline DUPIN/TAAF |
Contrairement au manchot empereur qui vit sur la glace, le manchot Adélie s'installe sur les rochers. Premiers arrivés, premiers servis. Les bonnes places sont chères et disputées.
-K300.jpg) |
| Céline DUPIN/TAAF |
Le job principal du moment ? Construire le nid qui accueillera les futurs œufs. Et pour cela, il faut des petits cailloux que le manchot Adélie transporte dans son bec et récupère où il peut...quitte à aller les "piquer" sur le nid du voisin.....De belles bagarres en perspectives.
Si l'empereur peut être qualifié de "pépère placide", le manchot Adélie est plutôt du style petit, sec et nerveux...
-K300.jpg) |
| Céline DUPIN/TAAF |
Sur l'ile des pétrels, il y a un emplacement rocheux qui fait l'objet d'une étude scientifique depuis 2011 : On l’appelle la colonie "Antavia"., Une sorte de talweg en forte pente où selon les années, de 400 à 700 individus vont installer leur nid. Ils y seront suivis par les ornithologues durant toute la campagne d'été : formation des couples, pontes, couvaisons puis éclosions des œufs, biométrie des poussins, transpondage de l'ensemble des individus....
Des manchots Adélie sont en train d'en prendre possession, il est donc temps de réinstaller les matériels d'étude. Caméras, balances, lecteurs de transpondeur.....
 |
| Iban FERNANDEZ/Institut Polaire Français |
C'est la tâche des personnels hivernants qui travaillent pour le programme scientifique IPEV P137, Emmanuel ci-dessus, Iban ci-dessous, auxquels il faut ajouter Paul et Laurent.
Deux points de passage obligés pour les manchots, en bas et en haut de la colonie. Iban l'électronicien, y installe des balances pour peser les manchots lorsqu'ils partent se nourrir en mer ainsi qu'à leur retour. Des lecteurs de transpondeurs permettent de repérer et suivre les individus préalablement équipés.
 |
| Emmanuel LINDEN/Météo France |
Comme vous pouvez le constater ci-dessous, les manchots n'ont pas le choix. Ils passent par ces passages équipés. Des barrières tout autour les y contraignent.
 |
| Emmanuel LINDEN/Météo France |
La colonie est prête. Tout en haut, la passerelle piétonne qui relie le quai maritime au bord de l'océan, à la base haute. Une cabine de veille, actuellement couchée, sera remise en fonction pour permettre à un ornithologue d'y prendre place et assurer un suivi visuel de la colonie lors des périodes d'observations continues.
 |
| Emmanuel LINDEN/Météo France |
Pour aller plus loin, le nom "Antavia" provient tout simplement de la contraction des deux mots ANTennes AVIAires. C'est un projet de suivi de colonies de manchots Adélie qui a débuté en 1998 sur l'ile de Crozet et se poursuit actuellement. En parallèle, à Dumont d'Urville, deux autres colonies sont suivies pour comparaison (celles de "hall fusée" et "Isabelle").
(article réalisé avec l'aimable concours de Laurent)